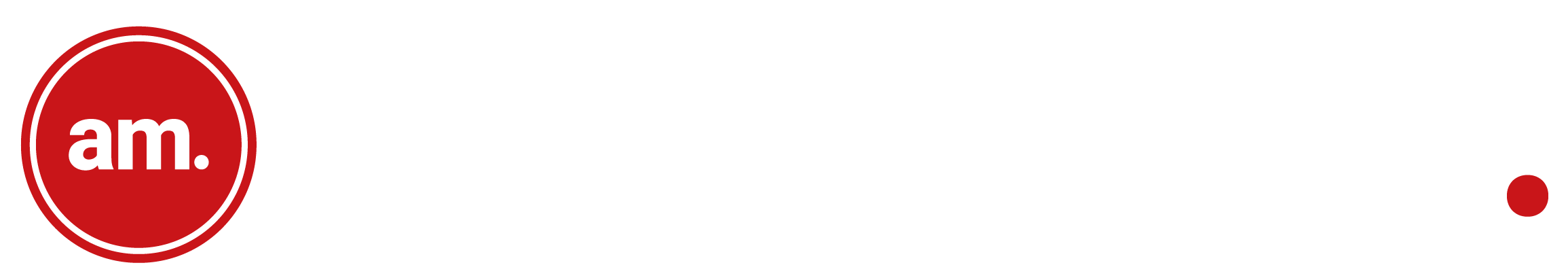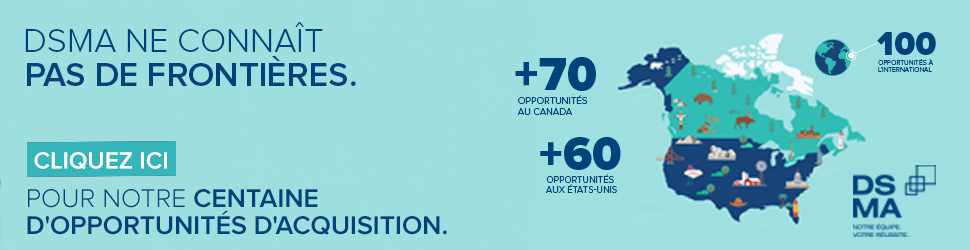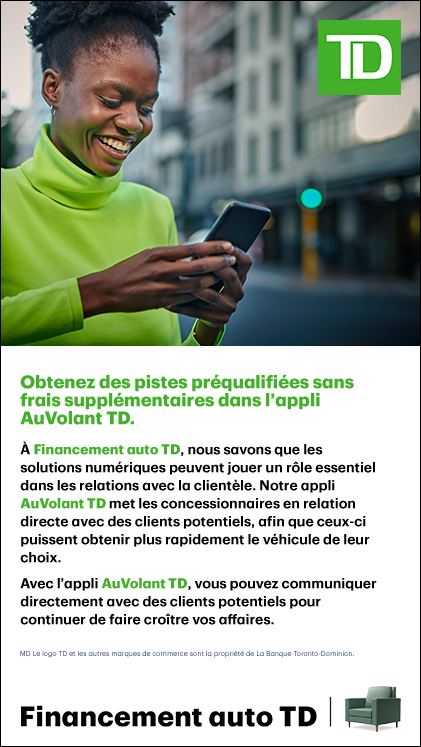Marché de vendeurs au Québec : une position avantageuse… mais pas sans nuances

Ce n’est pas un secret. Depuis quelque temps déjà, le marché des concessions automobiles au Québec a basculé en faveur des vendeurs. La combinaison d’un inventaire limité de concessions disponibles et d’une demande soutenue, notamment de la part de groupes établis et d’investisseurs aguerris, crée une dynamique où les vendeurs semblent en position de force. Selon les tendances observées, on estime qu’il y a actuellement entre 3 et 5 acheteurs sérieux pour chaque concession mise en vente au Québec, un ratio qui n’a jamais été aussi élevé depuis une décennie.
Un texte de Véronique Boucher, directrice de QUOTUS
Les facteurs en cause
Plusieurs facteurs alimentent ce déséquilibre : des conditions de financement encore relativement favorables malgré la hausse des taux d’intérêt, une certaine hésitation à la vente en raison de l’incertitude économique et des concessions encore en bonne santé financière, pour ne citer que ces exemples. C’est dans ce contexte que l’on parle volontiers d’un « marché de vendeurs ». Mais cette situation est-elle aussi avantageuse qu’elle n’y paraît ? Jusqu’où les vendeurs peuvent-ils réellement imposer leurs conditions ? Et surtout, comment éviter que cette position de force ne se transforme en excès de confiance… ou en occasion manquée ?
Depuis l’effervescence post-COVID, les attentes des vendeurs s’ajustent. Les valorisations reposent désormais sur les performances réelles de 2024 et 2025, laissant derrière elles les excès des années exceptionnellement favorables de la pandémie. Les acheteurs, quant à eux, deviennent plus sélectifs et résolus, et la surenchère reste aujourd’hui une exception réservée à des marques fortement convoitées telles que Subaru, Toyota ou GM. Ils adoptent une démarche à 360 degrés : ils ne se contentent plus d’analyser les résultats historiques, mais évaluent aussi la capacité future de la concession à croître ou à maintenir sa performance. Est-ce que le service est dimensionné pour accueillir plus de volume ? Le département des véhicules d’occasion est-il optimisé ? L’équipe F&I performe-t-elle à son plein potentiel ? Une concession déjà « au plafond » de ses capacités, sans marge d’amélioration claire, peut être perçue comme difficile à faire évoluer.
Des acteurs éduqués et expérimentés
Ce nouveau profil d’acheteurs, reflet d’un changement de mentalité dans le marché québécois, a profondément modifié la manière dont s’opèrent les transactions de concessions. Gracielle Sills, associée en fusions et acquisitions chez DSMA Québec, le résume ainsi : « Les acheteurs sont aujourd’hui nettement plus éduqués qu’il y a quelques années. Il n’est plus rare que les conseillers juridiques soient impliqués dès le début du processus. Les groupes sont désormais entourés de CPA spécialisés en industrie automobile, de consultants en gestion opérationnelle et de professionnels aguerris à chaque étape. »
Ce phénomène de professionnalisation crée une nette distinction entre acheteurs expérimentés et nouveaux venus. Les vendeurs, tout comme les constructeurs, favorisent des profils ayant déjà réalisé des transactions. Cela limite grandement l’accès au marché pour les « acheteurs débutants », qui peinent à inspirer confiance malgré leur motivation. « À moins d’avoir un partenaire stratégique ou des moyens exceptionnels, les acheteurs débutants ont très peu de chances », admet à contrecœur Gracielle Sills.
Le facteur humain
La longueur du processus de vente, généralement de 6 et 9 mois, définit la plupart des paramètres des transactions. Les concessionnaires auront plutôt tendance à privilégier des acheteurs aguerris et bien préparés, avec qui il est plus facile de collaborer, favorisant alors des échanges efficaces et fructueux. La fluidité et la qualité du processus deviennent des critères décisifs dans le choix du repreneur, une particularité très propre au Québec, où le marché se distingue de manière notable des provinces anglophones.
On constate ainsi que le lien humain peut faire toute la différence, et il n’est plus rare aujourd’hui de voir une entente relationnelle privilégiée au détriment d’une meilleure offre financière. Les vendeurs veulent savoir à qui ils ont affaire, établir une relation de confiance, voire amorcer une réflexion stratégique, même en amont d’un projet de vente. D’où l’importance de prendre contact avec des sociétés de conseils en fusions et acquisitions. Car la réalité se veut incontournable : les acheteurs qui refusent d’échanger directement avec les associés ou qui restent injoignables se voient rarement offrir les meilleures occasions sur le marché. Contrairement à certaines idées reçues, une discussion avec des conseillers n’implique pas nécessairement une volonté immédiate de vendre. La planification de la relève, l’évaluation d’entreprise, la recherche de partenaires minoritaires, ou simplement une meilleure compréhension de l’état actuel du marché restent des sujets inévitables pour tout simplement appréhender l’avenir en toute confiance. « Nous savons exactement ce que recherchent les acheteurs et à quoi nous attendre de chacun d’eux. Notre connaissance du marché québécois est fine, ancrée, et nous permet d’anticiper les besoins des deux parties », souligne Gracielle. C’est aussi la raison pour laquelle plusieurs acquéreurs de confiance accèdent à certaines opportunités en avant-première.
Vendre avec le vent dans les voiles
Sachant cela, quel est donc le meilleur moment pour se décider à vendre ? « L’erreur classique, explique Gracielle, c’est d’attendre que ça aille mal. En vendant quand l’entreprise va bien, on garde l’ascendant dans les négociations. » Trop attendre expose à des risques de retournement économique, ou simplement à un manque d’intérêt pour la marque ou l’emplacement. Et le processus est long : entre l’évaluation, les discussions, la vérification diligente et l’approbation du manufacturier, il peut durer jusqu’à deux ans. « Il faut commencer à planifier bien avant d’être prêt à quitter. » Même dans le cas d’une relève familiale, comme lorsqu’un parent souhaite transférer la concession à son enfant, plusieurs mois sont nécessaires pour structurer adéquatement le dossier et faire reconnaître ce dernier comme propriétaire-exploitant. Anticiper permet de conserver la maîtrise du processus. Cela offre également l’opportunité de vendre dans des conditions optimales, plutôt que dans la précipitation ou sous pression.
Le Québec : un marché unique
Pour finir, le marché québécois n’est pas simplement une déclinaison francophone du marché canadien mais un écosystème unique et à part entière. Ici, la confiance prime sur la concurrence, la préparation sur la précipitation, et la relation humaine sur la seule logique transactionnelle. Contrairement aux provinces anglophones, où les processus peuvent être plus directs, le Québec exige une approche plus réfléchie, plus enracinée, et souvent plus exigeante. C’est ce qui en fait un marché aussi riche qu’intransigeant. Dans cet environnement, il ne suffit pas de vouloir vendre : il faut savoir comment, à qui, et surtout, avec qui. « Chez DSMA, nous comprenons ces codes. Et nous savons que, dans un marché comme celui-ci, une seule conversation peut faire toute la différence. », conclut Gracielle.
Partager Partager